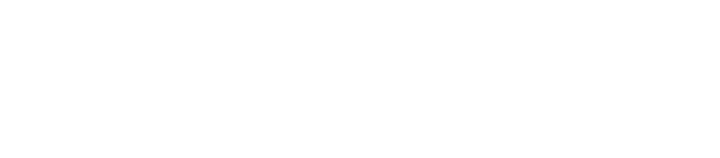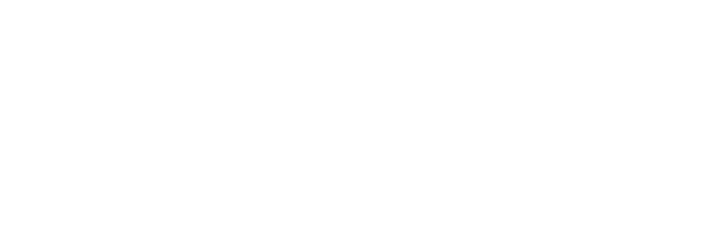Nous traversons une époque où nous sommes presque en permanence en état d’urgence, de crise, d’alerte, que ce soit climatique, sanitaire ou sécuritaire. Le sentiment de fragilité qui en résulte se traduit chez nous par un anthropocentrisme renforcé qui nous aveugle et nous empêche d’imaginer des futurs désirables.
Face à ce constat, la volonté de ce texte est de développer dans l’intérêt commun un point de vue autocritique en nous posant la question suivante : en quoi certains biais anthropocentriques nous conduiraient-ils à notre perte en déviant notre pensée de la réalité objective, et du coup en nous empêchant d’y faire face et de nous préparer un avenir plus serein ?
Comme charité bien ordonnée commence par soi-même, commençons donc en interrogeant dans ce sens le thème qui nous rassemble ici : Il faut sauver le vaisseau Terre ! Parler ainsi de la Terre comme d’un « vaisseau », c’est-à-dire implicitement comme d’un bien que nous aurions engendré et qu’en plus nous pourrions être en capacité de sauver, alors qu’en Californie durant l’été 2021 un incendie s’est révélé lui en mesure de générer son propre microclimat et en quelque sorte de s’autonomiser, à nos yeux de s’individualiser presque, devrait nous inciter à davantage de réflexion et de prudence dans le choix des mots que nous employons. Au fond, avons-nous beaucoup progressé depuis les anciens grecs qui inventèrent des divinités comme Poséidon pour expliquer des phénomènes naturels, nous qui continuons, par exemple, à donner des prénoms humains aux ouragans ?
Une nature déchaînée…
Soyons clairs : le mot seul d’anthropocène, qui s’est imposé via les médias dans l’opinion publique, nous enferme déjà dans l’idée d’une toute puissance qu’en réalité nous n’avons absolument pas. Est-il en effet vraiment raisonnable de penser que nos activités humaines pourraient mettre la planète en danger alors que l’actualité nous prouve régulièrement le contraire : que c’est nous qui sommes en danger ? De plus en plus souvent semble-t-il nous serions presque aussi impuissants que les hommes des cavernes face aux catastrophes climatiques.
Dans l’actualité récente à l’heure où j’écris ce texte, été 2021, sans parler du coronavirus qui dans l’absolu est une expression du vivant au même titre que nous, d’importantes inondations en Allemagne et en Belgique, de terribles incendies à plusieurs endroits de la planète, notamment en Grèce, en Turquie et chez nous, dans les Landes, des glissements de terrains meurtriers en Inde, toutes ces manifestations entre beaucoup d’autres, manifestations des forces de la nature et donc d’origines non-humaines, ont récemment tué des milliers des nôtres.
Paradoxalement nos lointains ancêtres étaient probablement mieux armés que nous pour faire face à de telles forces déchaînées et dévastatrices. Pour preuve, si j’écris ces mots et si vous les lisez c’est bien grâce à eux, c’est bien parce qu’ils ont survécu. Contrairement à nous, ils étaient habitués à ne pas avoir ni électricité, ni eau courante, ni smartphones, entre autres. En tous cas, notre extrême fragilité face aux forces de la nature ne fait aucun doute.
Si nous avons été surpris en juillet 2021, en France et en Suisse, par la panne subite des numéros téléphoniques d’urgence eux, les Cro-Magnons, n’avaient tout simplement pas de services de secours. Le confinement du printemps 2020 a bien montré à quelle vitesse la nature reprend le dessus dès lors que nous cessons de débroussailler et de bitumer.
Une nouvelle fois soyons donc bien clairs : c’est nous qui sommes en danger, c’est-à-dire qu’à plus ou moins long terme c’est la survie de notre propre espèce qui est en jeu, pas celle de la planète.
Des hommes enchaînés…
N’y aurait-il pas une véritable contradiction logique à considérer que nous serions à la fois suffisamment puissants pour détruire la planète et en même temps pas assez pour nous sauver ?
Alors que faire ? Très concrètement, nous devrions d’abord cesser de prendre les mots pour des idées et nous défier sérieusement des effets de pensée et de réel du langage.
Nous devrions toujours avoir présente à l’esprit la théorie linguistique exprimée à la fin des années 1930 par Edward Sapir et Benjamin Lee Whorf selon laquelle la façon dont nous percevons le monde dépendrait du langage que nous utilisons pour le décrire. Le plus souvent nous croyons nous dédouaner facilement en citant Albert Camus : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur de ce monde. », ou bien en postant par-ci par-là sur les réseaux sociaux quelques citations plus ou moins exactes de 1984 de George Orwell. Mais, pour prendre précisément ce dernier exemple : avons-nous seulement réfléchi sérieusement le sens profond de ce chef-d’œuvre ? Quelles sont au fond ses fondations et ses perspectives narratives ?
Un homme est enfermé dans une enceinte sous le contrôle d’une autorité paternelle omnisciente et omnipotente, il rencontre une femme qui le séduit et l’incite à transgresser les règles, mais ils sont démasqués et le poids de la faute retombe principalement sur la femme désavouée par son compagnon. C’est le même moule narratif que celui du mythe d’Adam et Eve. Comparer ce roman paru en 1949 avec ses deux précurseurs : en 1920 Nous autres de Ievgueni Zamiatine, et en 1938 Hymne de la philosophe et romancière américaine d’origine russe Ayn Rand est un bon exercice pour notre liberté de pensée.
Peut-être ne pouvons-nous pas, ou ne pourrions-nous que très difficilement, imaginer notre destin collectif en-dehors des textes judéo-chrétiens de l’Ancien Testament, mais il serait alors important d’en prendre enfin conscience et d’en tirer les conclusions qui s’imposeraient. Nos récits d’anticipation sont formatés par des biais cognitifs que nous devrions pouvoir rectifier si nous voulons nous émanciper d’une fatalité que nous aurions nous-mêmes forgée de toutes pièces.
Une obsolescence
programmée de l’humain ?
Ce que je propose ? Je pense vraiment qu’il nous faudrait commencer par renoncer au terme d’anthropocène qui nous enferme dans l’illusion au lieu de nous en délivrer.
Nous serions en guerre entendons-nous, mais contre qui ? Contre un ennemi non-humain et invisible à l’œil nu. C’est bien là la preuve que notre espèce animale n’est qu’une exception parmi une infinité d’autres et qu’au final elle ne pourra survivre que dans l’anticipation, l’entraide et la fraternisation.
Le rapport problématique entre la multitude incontrôlable, tout comme nous d’origine non-humaine, et tout ce qui nous environne, toute l’abondance irréductible de la création face au sentiment semble-t-il indépassable pour nous de notre propre singularité, pourrait trouver une ligne de fuite dans le jeu entre deux vieilles métaphores : celle du monde unique comme d’un livre singulier, et celle des livres multiples comme des mondes possibles et pluriels. Ce nouveau rapport à la lecture, tant celle des fictions que du monde, est ce que j’appelle le « bibliocène » et qui pour moi aurait vocation à remplacer l’anthropocène porteur de défaitisme.
Le mythe de Prométhée exprime bien cette idée qui traverse notre époque. Nous aurions volé le feu aux dieux mais pour cela nous serions maintenant enchaînés. Là aussi le sentiment d’une culpabilité ancestrale semble toujours nous poursuivre. Souvenons-nous que dans cette histoire Zeus ne punit pas seulement Prométhée, mais aussi les hommes auxquels il interdit l’usage du feu pour cuire les viandes. Le mythe nous poursuit toujours et il continue à agir sur nous. Que penser en effet dans cette perspective des injonctions véganes et de la formulation ubuesque de « viande végétale » ?
En 1956 déjà dans son essai L’Obsolescence de l’homme, le philosophe d’origine allemande Günther Anders pointait ce sentiment qui nous taraude aujourd’hui et qu’il désignait sous le nom de honte prométhéenne. L’idée est que nous nous sentirions humiliés face à la perfection et aux prouesses des machines que nous avons inventées.
Avec les technologies issues du numérique et notamment les débuts de l’intelligence artificielle, le phénomène s’amplifie dangereusement. La honte qui s’empare de notre espèce devient de plus en plus difficile à vivre. Nous le voyons bien avec les transhumanistes : pour eux nous devrions accepter la supériorité, sur nous pauvres mortels, des choses non-humaines, même et surtout de celles qui sont pourtant de notre invention.
Quelle issue de secours ?
Face aux prophéties auto-réalisatrices de nos propres mythes, l’enjeu est aujourd’hui de trouver notre juste place dans le grand cirque universel d’un écosystème global qui existe indépendamment de nos modes de pensée classiques qui restent toujours influencés par Aristote depuis près de 2 400 ans.
La cause de nos malheurs serait tout simplement notre ignorance, et l’aveuglement auquel elle nous conduit. Notre anthropocentrisme n’est qu’une manifestation d’orgueil en réponse au sentiment de honte prométhéenne que nous ressentons si vivement. Or, pour nous écrire un avenir possible et souhaitable, nous devrions d’abord pouvoir lire autrement notre passé et notre présent.
L’anthropocène, en effet, n’est que le triomphe de notre anthropocentrisme et il annonce notre perte. S’ils n’avaient compris qu’une seule chose les collapsologues ont bien compris cela.
Aussi, si nous voulons vraiment sauver notre espèce animale, nous devrions d’abord apprendre l’humilité et la prévoyance qui, comme la prospective, est l’art non pas de prédire mais de préparer l’avenir.
Crédit image : Pixabay | Mystic Art Design


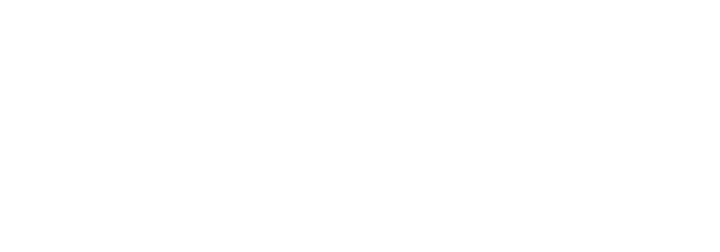


 Ecko Magazine
Ecko Magazine