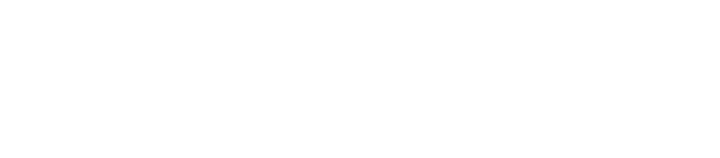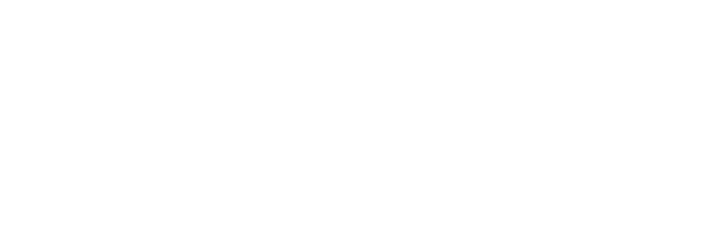Qu’il y ait des gens qui demandent à mourir, sans devoir faire l’effort de se suicider par leurs propres moyens, dans un monde où les armes sont d’un accès difficile et les poisons délivrés sur ordonnance, je le comprends très bien. Qu’ils cherchent à partir dans la dignité, sans souffrance excessive et sans courir le risque de se rater, rien de mieux. Mais la société, une fois de plus, déplace le curseur, entre choix personnel et usage collectif. Le droit au départ volontaire s’inscrit désormais dans une dynamique globale où la mort devient une marchandise exagérément valorisée.
La phrase « pas d’acharnement thérapeutique, docteur » a peut-être parfois servi à éviter des souffrances inutiles à un moribond au cerveau détruit qu’un médecin zélé essayait contre tout bon sens de maintenir en état de vie végétative. Mais ce n’est pas le cas le plus fréquent. Ayant visité, ça et là, en hôpital, des personnes de ma connaissance, très malades, peu entourées, peu stimulées, j’ai eu l’impression que l’acharnement à faire vivre un mortel à tout prix n’était pas la pratique la plus répandue.
« Pas d’acharnement thérapeutique, docteur », prononcé dès que le malade commence à décliner, a permis à un nombre remarquablement élevé d’enfants égoïstes ou avides de hâter la disparition de leur père et de leur mère, et d’en finir une fois pour toutes avec les corvées.
Le fait que les parents aient tendance à vivre de plus en plus vieux est pourtant un signal qui ne peut échapper à leurs héritiers : c’est le miroir de leur propre mort. L’octogénaire ou le nonagénaire qu’on « aide à partir » a des descendants largement sexagénaires, qui, longévité ou pas, ont toute leur jeunesse derrière eux, et comme avenir, une société où l’espace vital commence à se réduire sérieusement. Un peu de philosophie permettrait de s’interroger sur cette forme inédite du struggle for life.
Comment l’idée ne vient-elle pas à une génération d’orphelins retraités que le fait de pousser dans le vide des vieillards dont le désir de mourir reste à prouver, n’est pas sans danger pour eux-mêmes ? Ils favorisent bon gré mal gré l’avènement d’un monde où la mise à la retraite physique (qu’on continuera à appeler euthanasie, c’est-à-dire mort de qualité) sera décidée et signée de plus en plus facilement, sur des bases de plus en plus arbitraires, en vertu de considération de moins en moins compassionnelles ?
En somme, j’en parle à mon aise : mes parents sont morts, l’un au cours d’une opération, l’autre d’une crise cardiaque, sans que j’aie eu à me prononcer sur leur traitement et sur leur avenir. Et je n’étais pas le meilleur des fils. Mais ils avaient l’âme chevillée au corps et un goût prononcé pour l’existence terrestre. On ne pouvait pas se tromper en jugeant qu’ils ne souhaitaient pas devancer l’heure ultime de leur mort.
On sait bien, du reste, que la plupart des gens qui meurent à l’hôpital, ne meurent pas tout seuls, naturellement, mais que leur passage est facilité par le traitement, par la morphine, ou par la décision d’interrompre les soins, de ne pas tenter un nouveau protocole : pratiques qui me paraissent du niveau de l’acceptable, mais tout juste. Aller plus loin, ce n’est pas faciliter la mort volontaire, c’est favoriser les euthanasies de confort.
Jamais je ne voterai, ni n’accepterai, ni ne demanderai, une loi visant à autoriser les ayants droit ou les médecins à décider légalement de qui vit et de qui meurt. J’espère, pour ma part, quand je serai en train de perdre la partie, que j’aurai encore l’instinct de frapper l’individu qui voudra m’associer à mon assassinat. Rien ne presse, lui dirai-je plutôt, l’index glissé entre deux pages de mon livre pour ne pas perdre le fil. J’aurai pris un visage avenant, sous les rides du 5e âge. Il faut se montrer patient et poli, pour mieux tromper l’adversaire, et ramasser ses dernières forces. u LD


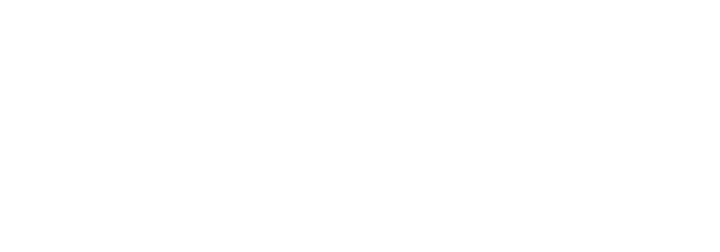


 Ecko Magazine
Ecko Magazine