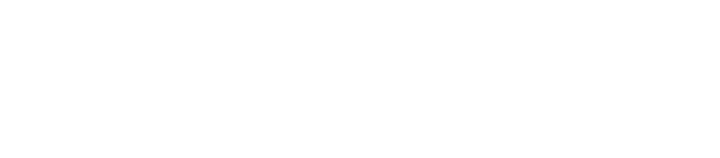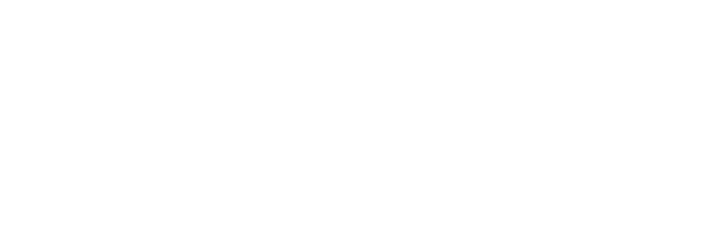Nom du mal concerné rabâché. Surinformation et désinformation. Métaphores inappropriées. Les mots et les interprétations que nous en faisons sont en première ligne de ce qui n’est pas une guerre mais une crise du métabolisme naturel d’une espèce animale qui ne cesse de fabuler sa destinée. Ce sont des utopies qu’il nous faut d’urgence !
Nommer n’est jamais sans effets. Et pour commencer peut-être pourrions-nous, comme le faisaient les romains pour les Furies, les grecs pour les Érinyes, ces divinités persécutrices, renommer le [ne pas prononcer le nom] d’un sobriquet de substitution. Cela ne le ferait pas disparaître, mais cela lui concéderait moins d’emprise sur notre mental et sur notre moral. Cela ferait retomber le niveau de stress ambiant et renforcerait d’autant nos capacités collectives de résistance.
L’aide venue des mondes de fiction
Substituer un nom à un autre nous ouvre en effet un éventail de réécritures et de relectures. C’est le principe inscrit dans l’étymologie même des métaphores qui portent [phorós] au-delà [méta] et sont ainsi de bons moyens de locomotion d’un monde à un autre.
Nous l’avions déjà constaté en 2015 après les attentats terroristes, en 2019 avec l’incendie de Notre-Dame de Paris : lorsqu’un traumatisme collectif nous sidère nous en transférons le sens dont il est porteur dans un monde fictionnel au sein duquel il peut se cristalliser à notre entendement sans nous aveugler. Mais sommes-nous toujours conscients alors des effets de distorsions qui peuvent opérer entre monde réel et monde fictionnel ?
En 2015 le titre du livre d’Ernest Hemingway, Paris est une fête est trompeur. Au mieux il s’agit d’un récit sur ses années de bohème. Le véritable livre de la fête chez Hemingway serait plutôt Le soleil se lève aussi. Quant à Notre-Dame de Paris, si on peut y voir dans quelques lignes une vision prophétique de l’incendie, la grande machinerie hugolienne nous entraîne bien loin.
Mais ces livres, comme d’autres, ont cependant permis à des milliers de lectrices et de lecteurs de dépasser l’émotion par une lecture réparatrice rendant possible, dans un monde fictionnel, la cristallisation de ce qui dans le réel dépassait leur imagination.
En ce mois de mars 2020 (Mars, dieu de la guerre dans la mythologie romaine, soit dit en passant) deux romans peuvent être de meilleurs phares pour nous éviter les écueils et le naufrage. D’abord Le hussard sur le toit de Jean Giono, où une allégorique épidémie de choléra en Provence dans les années 1830 est prétexte à révéler le pouvoir de la vertu face aux épreuves. On y entend dans la bouche d’un personnage : « Choléra, c’est beaucoup dire et c’est avec des mots qu’on fait peur. Si on laisse arriver la peur, on ne pourra plus faire un pas. ».
Puis La peste d’Albert Camus évidemment. Il s’agit là du nazisme, de la peste brune, mais ces quelques mots suffisent à montrer l’urgence de le relire : « Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l’ignorance, et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté, si elle n’est pas éclairée. ».
Les leurres de l’auto-fictionnalisation
Quels risques courons-nous aujourd’hui si, au lieu de telles allégories littéraires cherchant à élever notre esprit, les industries du divertissement et le marché du livre nous abrutissent de dystopies ?
Une autre contamination agit, au niveau du langage, du vocabulaire. Nous constatons tous que les médias grand public, amplifiés par les réseaux sociaux, déforment l’information en lui appliquant les codes narratifs en usage dans les fictions, films et séries massivement diffusés. Audience oblige.
Nous observons aussi chez certaines personnes un phénomène de fictionnalisation de soi. Beaucoup semblent dramatiser la situation à plaisir pour se donner de l’importance, pour avoir l’impression valorisante de vivre un moment vraiment important et dangereux comme en connurent leurs ancêtres.
Un peu plus d’humilité serait souvent bienvenue je crois. Un effet boule de neige incontrôlé pourrait grossir démesurément quelque chose qui aurait été de moindre gravité abordé sereinement.
Ce miroir déformant de l’auto-fictionnalisation est révélateur de notre égocentrisme naturel qui nous impose une lecture centripète du monde, lecture dans laquelle nous ne pouvons interpréter (lire) tous les événements que par rapport au récit que nous nous faisons nous-mêmes de notre propre vie.
Ne l’oublions pas : « Le choléra fini, il restera les miroirs à affronter. » (Jean Giono – Le hussard sur le toit).
Probablement sommes-nous déjà bien plus conditionnés que nous le pensons, tant par les fausses nouvelles que par les récits apocalyptiques. Même si certaines peuvent avoir une fonction cathartique, et si beaucoup sont davantage dénonciatrices que prophétesses, les dystopies sont par nature porteuses d’une véritable lèpre morale.
Le vaccin des contre-récits
Incontestablement il y a dans le réel des effets de fiction qui nous étonnent toujours. « La réalité dépasse la fiction ! » est une impression semble-t-il de plus en plus courante. Mais pourquoi toujours nous référer à la fiction pour penser le réel ? Parce que nous sommes une espèce fabulatrice.
Pour nous la fiction surpasse la réflexion en ce sens que celle-ci ne fait simplement que refléter, alors que celle-là engendre. Et qu’elle peut engendrer la compréhension du réel.
Un livre à lire ou à relire en ce moment est certainement l’essai de Nancy Huston paru en 2008 aux éditions Actes Sud : L’espèce fabulatrice. Elle y explore comment « La narrativité s’est développée en notre espèce comme technique de survie », pour en conclure que : « La vie a des Sens infiniment multiples et variés : tous ceux que nous lui prêtons. ».
Soyons francs avec nous-mêmes : nous est-il possible de nous confronter à la réalité sans passer par le filtre de la fictionnalisation, sans nous raconter des histoires qui permettent à notre mental de penser notre vécu et à notre conscience d’exercer son regard critique sur le réel ?
Alors… Les dénis de fiction dans la réalité seraient-ils finalement tout aussi graves que les dénis de réalité dans… la réalité ?
Ce qui est grave en fait ce sont les dystopies qui nous programment mentalement au pire, nous préparent à nous résigner à des maux en apparence moindres, nous incitent à penser que le mal serait inéluctable.
Je ne crois pas à l’inéluctabilité du mal. Je la refuse. Je dis que face aux récits de la collapsologie nous avons besoin d’utopies vers lesquelles ressourcer notre foi en l’humanité.
La sérénité, cette page blanche que nous pouvons toujours étaler devant nous, c’est à nous de l’écrire. C’est de cette sérénité que nous avons besoin pour fabuler l’après… Chut.
Nous devons retrouver l’espérance et la confiance dans des contre-récits utopiques. Car nous ne sommes pas en guerre, simplement nous ne savons toujours pas déchiffrer (lire) le destin de notre espèce animale, de notre espèce fabulatrice pour laquelle, semble-t-il, tout finit en récit.


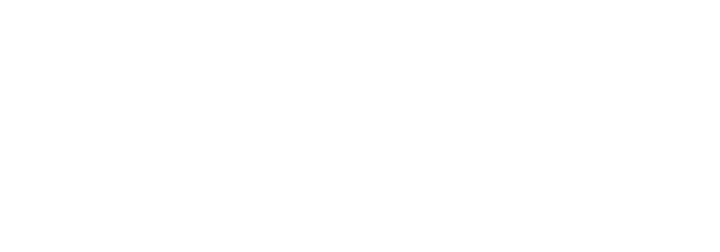


 Ecko Magazine
Ecko Magazine