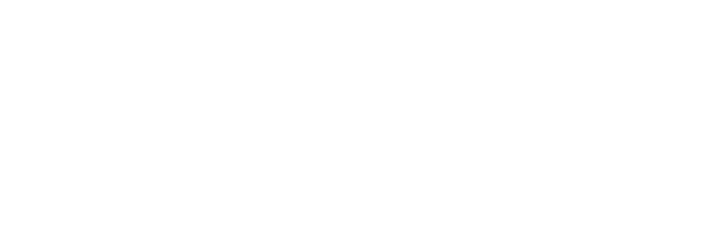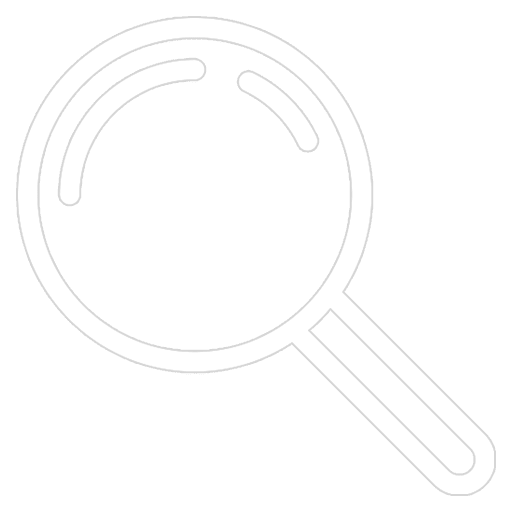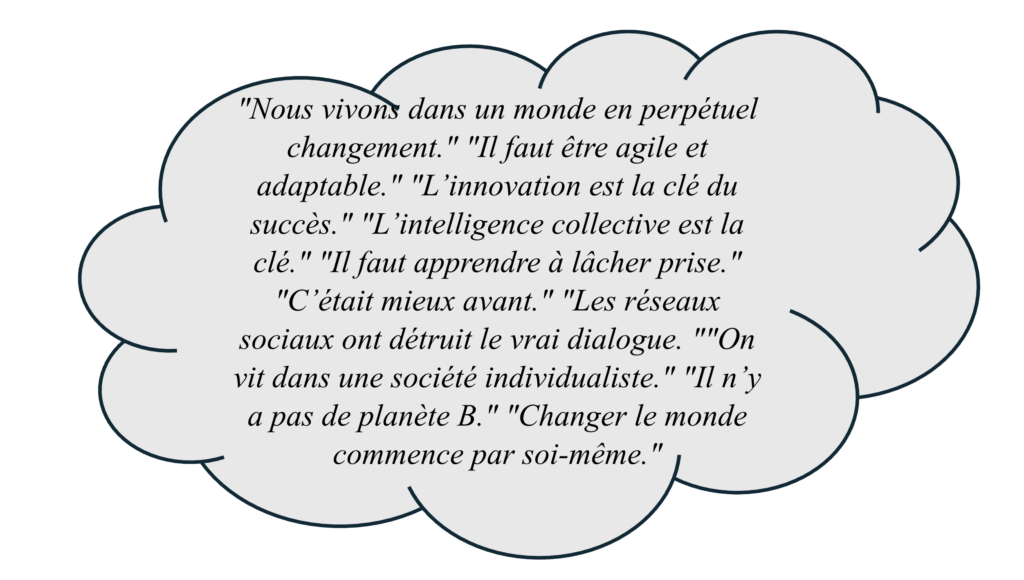Pour mémoire – si je puis dire, pun intended comme disent les anglais – la léthologie, ça vient du grec ancien Λήθη / Lếthê, « oubli » et via le latin -logia, du grec ancien -λογία, -logia. Bref trou de mémoire.
Le palimpseste, le poncif et le fenouil m’ont toujours échappé. Ces trois mots se glissent dans les interstices de ma mémoire. Ils me filent entre les doigts. Je les ai sur le bout de la langue et ils me narguent. Ils sont stockés quelque part mais il me faut toujours repartir en quête d’indices contextuels pour qu’ils se révèlent à nouveau.
Cette fois je les ai fixés sur la feuille, sur l’écran, et je peux les interroger à loisir.
A quoi peuvent servir des trous de mémoire dans les exercices de prospective ?
Ces trois mots me narguent, dis-je. Ils volent en escadrille, passent en coup de vent, j’en retiens un, l’autre file en douce. Mais maintenant que je les ai piégés ici on va examiner ça de près.
Le palimpseste symbolise le phénomène de réécriture et de reconfiguration des strates narratives ou historiques : on efface pour mieux réécrire. Le terme est issu du grec palimpsestos signifiant « gratté de nouveau ». Le passé, bien que théoriquement effacé, demeure en filigrane. Avec l’IA aujourd’hui on récupère tout.
Le poncif renvoie, bien sûr, à l’idée d’un cliché, d’une formule toute faite, souvent paresseuse. Cette structure mentale collective sert de repère culturel et langagier. En prospective elle permet de déconstruire ou de transformer pour y injecter du sens nouveau.
Le fenouil symbolise le rajeunissement spirituel. Pline assure qu’il avait la propriété d’éclaircir la vue et que les serpents qui y goutent se rajeunissent périodiquement. Ce légume/fruit aux merveilleux pouvoirs régénère les idées, les adapte à des contextes inédits.
Irais-je jusqu’à écrire que l’idée de planter un « poncif » dans un « palimpseste » pour qu’il devienne un « fenouil » suggère qu’un cliché semé dans un terrain conceptuel complexe peut grandir en un nouveau récit.
J’ai toujours été tenté de replacer les phénomènes culturels et artistiques dans un cycle permanent de mort et de renaissance, de destruction créatrice. Cette approche de la prospective est bien tentante : puiser dans des matériaux anciens (palimpseste), les soumettre à des codes, parfois pétris de lieux communs (poncifs) pour produire une nouvelle interprétation, un nouvel objet (fenouil) apte à s’épanouir dans le paysage contemporain.
Le palimpseste peut être interprété comme une métaphore des couches de l’inconscient collectif riche de motifs archaïques et de structures symboliques qui réécrivent sans jamais s’effacer totalement.
Le poncif, en tant que lieu commun, s’inscrit également dans cette perspective, représentant une structure mentale collective servant de repère culturel et langagier. Toutefois, il peut aussi enfermer la pensée dans une certaine rigidité, réduisant ainsi la diversité interprétative au sein des récits et des représentations culturelles.
C’est là que le fenouil entre en scène : il est l’élément médiateur entre le palimpseste et le poncif il incarne un cycle de régénération qui rappelle à la fois la dynamique de superposition du palimpseste et la permanence structurelle du poncif. Prométhée a volé le feu aux dieux en le cachant dans une tige de fenouil, conférant à cette plante une dimension initiatique et symbolique.
Et donc à quoi peuvent servir ces trous de mémoire dans les exercices de prospective ?
Peut-être que l’inconscient collectif et les stéréotypes (mes « poncifs ») se superposent à la trame de mes représentations (le « palimpseste »), avant d’éventuellement ressurgir sous une forme nouvelle ou réinventée (symbolisée par le « fenouil »).
Cette dynamique d’oubli et de rémanence permet de souligner que l’avenir n’est jamais totalement construit à partir d’une table rase : même lorsque nous tentons au sein du Comptoir Prospectiviste de projeter des scénarios inédits, nous héritons d’un substrat d’images, d’idées et de souvenirs collectifs qui se réécrivent et s’adaptent sans cesse.
Ainsi, les trous de mémoire ne sont pas qu’une simple défaillance cognitive : ils révèlent la tension entre la permanence des repères culturels et la quête d’innovation, un jeu subtil entre effacement et réinvention.
La morale de l’histoire ?
L’oubli fertile ! Ce qui m’échappe alimente les récits futurs. L’oubli dépoussière et permet de générer de nouvelles façons de penser. La prospective, pour être véritablement créative, ne doit pas chercher à faire table rase du passé, mais plutôt s’en nourrir de manière souple et consciente. Le futur se construit ainsi sur l’assemblage de bribes mémorielles, de fragments symboliques et de codes collectifs, tous soumis à un jeu de recomposition permanente. L’oubli est l’allié paradoxal d’une imagination plus vive, car il invite à explorer sans relâche les multiples facettes du temps, de la culture et de la pensée.
On pourrait en faire un code de conduite de prospective. Dis-moi ce que tu oublies je te dirais où tu nous emmènes.



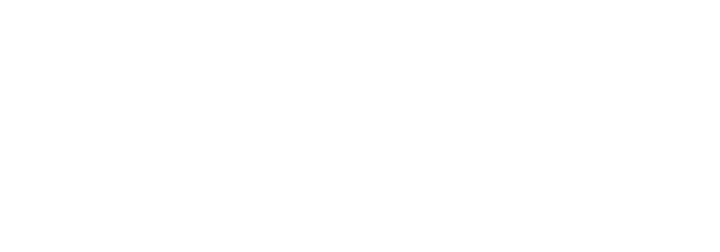
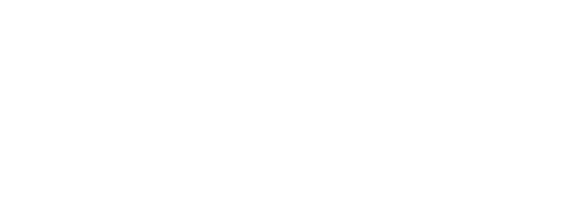

 Ecko Magazine
Ecko Magazine