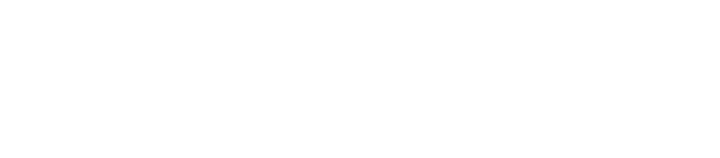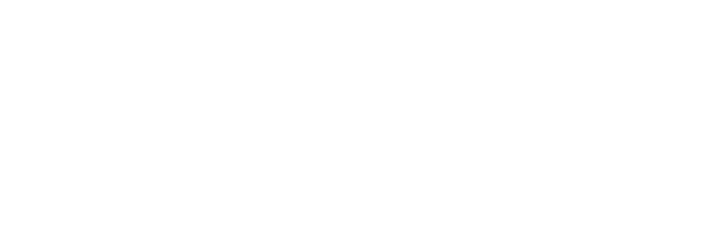Il y a vingt ans : j’ai vingt-cinq ans, Hakim douze. Classe de cinquième, leçon d’histoire dans un collège de banlieue : le sacre de Charlemagne. La civilisation médiévale est au programme, avec Dieu partout dans son sillage. Mes élèves papillonnent. Mais Hakim est là, au premier rang, concentré les yeux levés sur moi qui m’agite sur l’estrade. Appuyé sur ce regard confiant, je me lance dans une explication alambiquée. Comment leur faire toucher du doigt la scène du sacre ? Le pape, l’empereur, l’huile sainte… pas facile d’être claire devant ce public assez peu familier du dogme catholique. Comment faire ? Une idée de secours me vient à l’esprit. Choisir Hakim comme complice, le faire venir sur l’estrade avec moi. Il est d’accord, enthousiaste, comme d’habitude. A cet événement inattendu, les copains font silence. Enfin ! Hakim, tu serais Charlemagne et moi je serais le pape. Me voici donc, face au très sage Hakim, mimant les gestes historiques de l’an 800, concentrée sur un seul objectif : faire comprendre à nos spectateurs médusés ce moment décisif de l’histoire de l’Europe et de la Chrétienté. Tout à coup, dans les yeux d’Hakim, un voile d’inquiétude que je ne lui connaissais pas. Je m’apprête à faire semblant de signer d’une croix son front qui est immense. Il m’arrête d’un murmure : madame, je ne suis pas chrétien… je suis musulman… Je l’avais oublié. Le regard affolé vers les vingt-trois autres visages suspendus à mes lèvres, je choisis d’en rire : Ne t’inquiète pas … je ne suis pas pape !
Hakim doit avoir trente-trois ans aujourd’hui. Et je pense à lui. A la manière tranquille et souriante dont nous avions su nous respecter ce jour là. Il est certainement aussi en colère que moi. Lui avait choisi, très tôt, l’école de la République, ses exigences et le chemin d’espoir qu’elle lui traçait. Il se faisait traiter de bouffon tous les jours. Il s’en moquait. Il était brillant et courageux. C’était un garçon exceptionnel. Dans ce collège de quartier, je me souviens que les filles de la classe s’accrochaient et réussissaient parfois magnifiquement. Les garçons eux, peinaient davantage, regardaient avec envie les filles dessiner un avenir dont le bac serait la première victoire. Les garçons tournaient en rond comme des lions dans la cage de leurs défaites scolaires. Et nous, leurs professeurs, nous nous battions tous les jours, pour les en sortir : hussards désarmés d’une République qui avait abandonné son école. Alors c’est vrai, nous avions des moyens, ceux de l’éducation prioritaire, des primes bienvenues (500 euros par an à l’époque !) pour les jeunes professeurs sans fortune et sans expérience que nous étions. Mais cela ne changeait rien à notre quotidien, celui d’une concentration inouïe de difficultés sociales et scolaires, le quotidien de nos élèves, le quotidien d’un ghetto qui ne disait jamais son nom. Les garçons grandissaient, 4e, 3e… Une poignée suivait Hakim vers les filières générales du lycée, certains trouvaient une porte de sortie dans une seconde professionnelle qu’ils n’avaient pas choisie. Et quelques-uns nous quittaient… sans laisser d’adresse.
Vingt ans ont passé. J’ai quitté le front de la grande difficulté scolaire depuis bien longtemps et l’éducation prioritaire vient de connaître la troisième réforme de son histoire. Pour autant, les ghettos scolaires ont-ils disparu ? S’est-on d’ailleurs donné les moyens statistiques de les identifier ? Peut-on, dans tous les collèges et lycées de France enseigner la shoah, sans crainte de voir l’antisémitisme ressurgir à la moindre question sur le conflit israélo-palestinien qui, à cette occasion, ne manquera pas d’advenir ? Mais surtout, a-t-on réussi à réduire le taux des élèves massivement issus des milieux populaires, qui sont en situation d’échec dès l’entrée en 6e ? A-t-on fait de la voie professionnelle une voie d’excellence ? A-t-on cessé de demander aux plus inexpérimentés des enseignants d’affronter les défis pédagogiques les plus compliqués ? Forme-t-on les professeurs à l’exercice d’une laïcité aussi ferme que bienveillante ? Dans les quartiers, les garçons ont-ils autant de chances que les filles de réussir? A toutes ces questions, la réponse est sans appel : non. En 2015 comme en 1995. Dans les minutes de silence que l’on ne sait plus faire respecter, on découvre aujourd’hui les enfants perdus de la République. Il n’est pas trop tard. Les échecs de l’école n’excusent en rien la barbarie que vient de connaître notre pays mais notre aveuglement sur ces échecs serait coupable.
Alors, à nous qui servons l’école de la République tous les jours, professeurs, mais aussi chefs d’établissements, conseillers d’éducation, agents techniques et administratifs, conseillers d’orientation, inspecteurs, à nous de ne plus rien céder sur nos valeurs ! A nous d’engager une guerre sans merci contre l’échec scolaire qui nourrit toutes les humiliations et à nos élus de reconstruire la mixité sociale dans nos établissements pour nous y aider. Les plans d’urgence, les réformes et même les milliers de postes que plus personne ne veut occuper n’y suffiront pas. Il faudra bien, sur chaque territoire, emprunter d’autres chemins, travailler différemment, ensemble mais aussi avec les familles, les élus, les entreprises. Il faudra oser le projet, oser l’autonomie véritable des établissements, évaluer collectivement et régulièrement les équipes, rendre aux professeurs une dignité matérielle mais aussi symbolique. Il faudra faire autrement. Serviteurs engagés de l’école, soyons des serviteurs libres de la repenser. Ayons cette idée folle de réinventer l’école.
© Bénédicte Durand, Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche


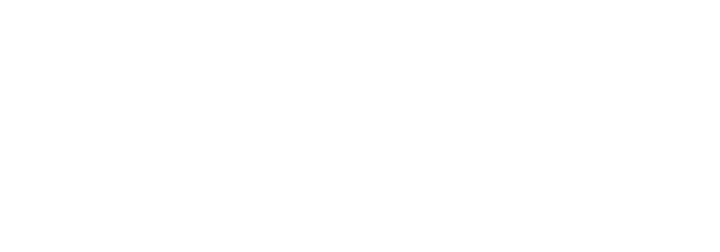


 Ecko Magazine
Ecko Magazine