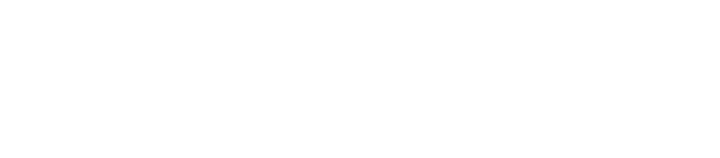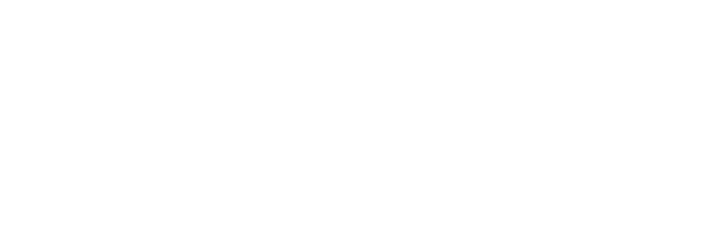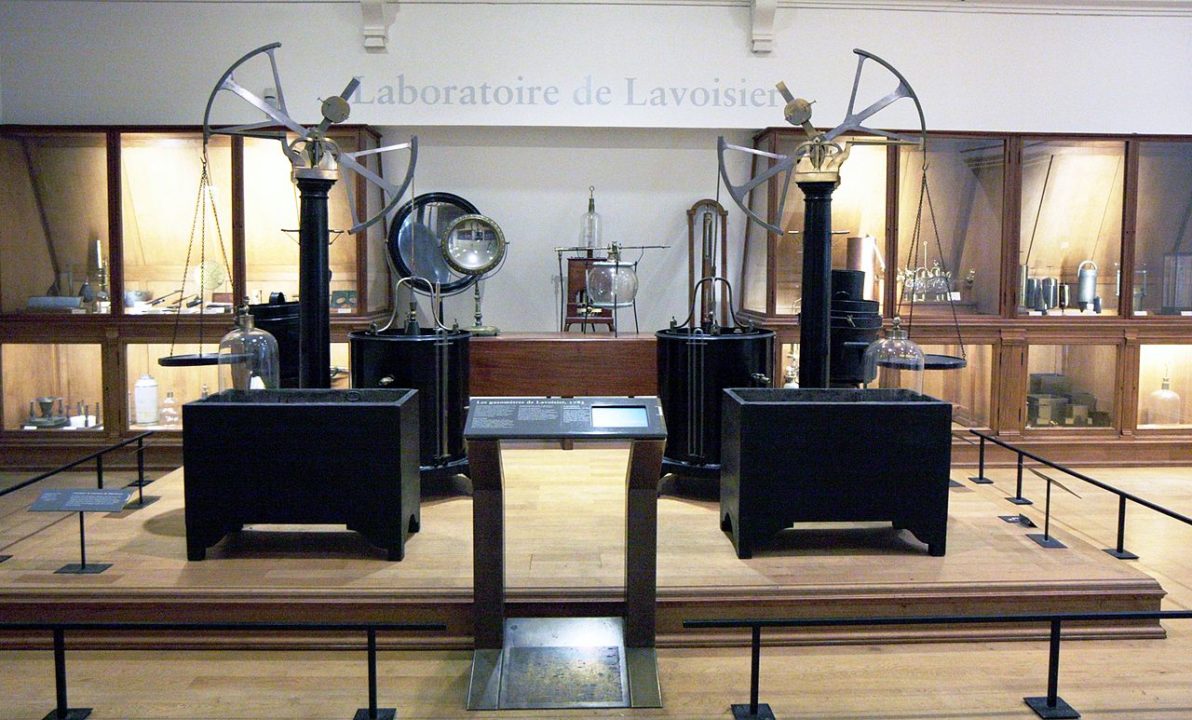Il arrive que l’Histoire se répète, et il arrive qu’elle innove absolument.
Lorsqu’une cité entière périt dans les flammes, qu’une guerre ravage un continent, qu’une population se modifie, qu’un empire disparaît, on peut dire, malgré la gravité de ces événements, que cela s’est déjà passé, non pas une fois, mais dix ou cent fois, et qu’à l’échelle de notre espèce humaine, cela reste un avatar. La sagesse humaine le dit depuis trois mille ans : tout s’est produit, se produira encore, et c’est ne rien savoir que de croire que le neuf est nouveau.
Mais la sagesse, justement, la sagesse vivante, ne consiste pas à refuser de voir les changements du monde et les phénomènes inédits, mais à les mettre en rapport avec les phénomènes du passé, pour juger de ce qui relève de l’éternel retour, et de ce qui, peut-être, se produit pour la première fois.
Jusqu’au début du XXe siècle, le monde demeurait sans limites, et jusqu’au milieu des années quatre-vingt, il n’en était pas venu à consommer les ressources au-delà de ses capacités de découverte ou de renouvellement. Être entré dans l’ère du monde fini, et de l’extinction quantifiable des ressources, est une circonstance sans commune mesure avec le passé.
En ce premier quart du XXIe siècle, les conditions de vie et les perspectives d’avenir s’écrivent d’une encre qui n’existait pas à l’époque de Pline le Jeune, ni de Montaigne, ni de Tocqueville, ni de Galbraith, ni même de Philippe Muray. C’est connaître l’histoire, et non l’ignorer, qu’affirmer que nous vivons la fin du monde pour la première fois.
Cette fin du monde n’est pas forcément, pas probablement, un cataclysme qui rayera la Terre de la carte des étoiles : c’est l’accroissement et l’accélération de circonstances nouvelles propices à un basculement intégral.
Rien de nouveau sous le soleil ? Bien sûr que si, et c’est maintenant que cela vérifie, presque à l’œil nu. Quoi ? Sept à huit milliards d’habitants, le brassage absolu des peuples sur toute la surface du monde, le tout commercial universel, la raréfaction quantifiable de l’eau et des énergies fossiles, le réchauffement tangible des climats, l’omni-surveillance électronique, les astronefs et les sondes spatiales, l’interconnexion et l’autonomie des appareils de savoir à distance, la PMA, l’intelligence artificielle, auraient déjà existé d’une façon ou une autre dans le passé humain ? Ou, ce qui revient au même, ce seraient d’autres formes d’une réalité qu’on a déjà connue ? Et le pouvoir de ravager et de détruire la planète par la puissance atomique n’aurait pas un sens différent de celui d’un cyclone ou une épidémie ? Allons donc.
L’époque que nous vivions ne ressemble à aucune autre, sauf de loin, de très loin. C’est manquer de vision et même de simple bon sens que de citer, à son propos, par analogie, la chute de l’Empire romain, la grande peste de la fin du moyen-âge, l’hécatombe de Nagasaki, ou le génocide partiel ou complet de vingt peuples, sur cinq continents. C’était l’âge des désastres partiels, irréparables mais dépassables. Un âge nouveau est arrivé, de plusieurs côtés à la fois, sous des espèces terribles, et il n’est pas une redite du vieux, il est neuf réellement.
Sur cinq points essentiels : surpopulation, usure des ressources, règne des machines intelligentes et sous-contrôlées, économie mondiale de la dette, pouvoir de destruction intégrale, nous avons innové, et les leçons du passé sont soit muettes, soit si métaphoriques qu’on peut dire qu’elles ont tous les sens qu’on voudra.
Il n’y a eu aucune voix compétente, hormis peut-être celle de Freeman Dyson, pour dire le changement radical de la donne dans sa forme historique réelle : celle du quitte ou double de l’aventure humaine. Ce n’est pas un hasard si toutes les pistes qu’il évoque, telle la sphère de Dyson, ont un air de science-fiction. Quand le piège se referme et l’histoire se fait édifiante, les seules issues sont fictionnelles.


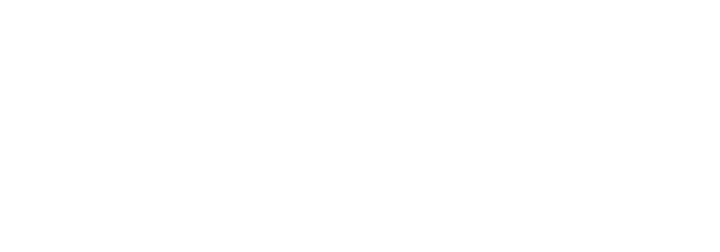


 Ecko Magazine
Ecko Magazine